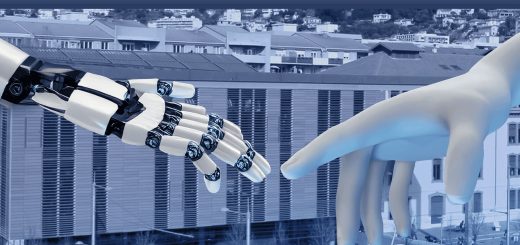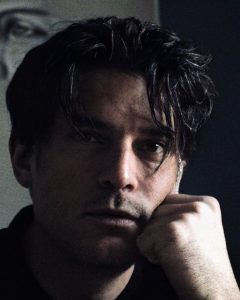Parution

Communications et incommunications en Méditerranée.
Quels impacts des plateformes numériques ?
N° 16 REFSICOM. Juillet 2025
Coordination : Billel Aroufoune, Alexandre Joux, Enrique Klaus
La diversité, caractéristique de la Méditerranée, est à la source d’influences réciproques, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Dans son ouvrage classique associé à l’École des Annales, Fernand Braudel (2017) analyse ainsi la richesse des échanges commerciaux et communicationnels tous azimuts sur et autour de la Méditerranée, en des temps marqués par un niveau de développement technologique bien inférieur à celui de notre époque. L’historien insistait sur les liens tissés entre populations de cultures différentes, réunies sous l’appellation-label de « Mare Nostrum » et par le destin commun qu’elle symbolise.
Espace d’échanges et de rencontres, la mer Méditerranée est aussi traversée par des lignes de fracture, souvent marquées par l’incompréhension — ou une compréhension inégalement partagée et asymétrique confinant parfois à la violence. La Méditerranée voit s’entrechoquer des espérances souvent contrariées, entre un « Nord » riche mais frileux, et un ou des « Sud(s) » où les libertés sont globalement limitées, le développement économique entravé. La « différence » ne suit pas seulement une ligne sud-nord de démarcation. Pensons aux Balkans, pensons aux tensions qui traversent les trois États du Maghreb central. Partout, pourtant, les images et les paroles circulent, notamment sur les réseaux sociaux numériques (RSN). Les imaginaires se percutent, au risque parfois de l’incompréhension, voire du rejet. L’altérité est dans quelques cas déniée, laissant place à une forme de radicalité qui se déplace, se dissémine et brouille les frontières entre espace public et espaces d’expression numériques que les plateformes institutionnalisent.
Aussi, l’espace méditerranéen, objet de conquête et de discorde territoriales (Dézéraud, 2022), nous invite à interroger la place de la communication dans la constitution d’identités plurielles, paradoxalement rassembleuses et singulières (Rasse, 2013). Dans un tel contexte, comment appréhender la diversité, cet étendard de la « communication monde », à l’heure où les plateformes numériques imposent une redéfinition des liens et des usages ? Entre dispositifs médiatiques, dynamiques d’actions collectives et formes d’expression des mouvements sociaux, en Méditerranée, les problématiques se multiplient à l’image de ce qui la définit : la complexité.
Ces legs contrastés de la diversité qui unifie la Méditerranée nous rappellent que la communication a irrémédiablement pour revers l’incommunication (Dumas, 2016). L’une est le corollaire de l’autre : parce qu’elle repose de manière essentielle sur la relation entre une diversité d’acteurs, la communication peut dégénérer et se métamorphoser en acommunication quand, à défaut de consensus minimal et de représentations partagées, le dialogue devient véritablement impossible (Wolton, 2019).
Ce numéro 16 de la revue REFSICOM questionne les enjeux de la communication et des incommunications en Méditerranée dans la période la plus récente, parce qu’un acteur nouveau et tendanciellement hégémonique s’est imposé dans nos pratiques communicationnelles : les plateformes numériques.
Le terme de « plateforme » est tombé dans le langage commun et a acquis une acception de plus en plus large, au point de perdre sa spécificité (Bullich, 2021). Il servira ici à désigner toutes les formes d’intermédiation et de participation caractéristiques des dispositifs techniques déployés par les acteurs globaux du numérique tels que Google, Meta ou TikTok, mais également les dispositifs numériques participatifs plus confidentiels, ceux par exemple utilisés dans les « civic tech ». La logique participative est centrale dans les « plateformes » et explique leur capacité à s’imposer au cœur de tous nos échanges, qu’ils passent par de « petits » dispositifs ou par les plus célèbres des réseaux sociaux numériques. Pourtant, aucun des articles proposés ne cède au techno-déterminisme. La communication reste fondamentalement une activité humaine, quand bien même recourt-elle à des techniques, ce qui explique pourquoi la question des RSN est saisie d’abord au prisme des enjeux sociaux et politiques en Méditerranée, et pourquoi elle est également inséparable des problèmes d’incommunication et d’acommunication. Tous les auteurs mobilisent par ailleurs la notion d’engagement : la communication nous engage, l’engagement peut provoquer l’incommunication, l’engagement est le mantra des RSN, l’engagement est politique, citoyen, émotionnel. Finalement, croiser les enjeux de communication et des incommunications en Méditerranée, au prisme des plateformes, nous conduit à penser les engagements dans leur diversité, dans une perspective d’abord infocommunicationnelle.
Retrouvez l’intégralité des textes de ce numéro en cliquant : ICI